Werner Stampfli (chef de l’inspectorat des sapeurs-pompiers des deux Bâle) a fait partie dès le début de l’Equipe didactique et développement de l’International Fire Academy. Lors de notre 14e Forum en ligne, il était notre invité en studio et a répondu aux questions de Christian Brauner. Il a notamment été question de savoir où en sont actuellement les services d’incendie et de secours en matière d’interventions dans les tunnels.
Les interventions dans les tunnels sont-elles devenues une routine?
Plus d’un quart de siècle s’est écoulé depuis les incendies survenus dans le tunnel du Mont-Blanc et dans celui du Tauern en 1999. Les enseignements tirés de ces interventions et les nombreuses années de formation qui ont suivi ont porté leurs fruits. Mais, pour Werner Stampfli, les interventions dans les tunnels ne sont actuellement pas encore devenues une routine.

Werner Stampfli constate: «Les interventions dans les tunnels réalisées dans notre pays et il en va de même selon les collègues allemands, autrichiens et autres qui sont venus s’entraîner ici, se déroulent de façon définitivement plus structurée et standardisée.» Cela favorise également la collaboration entre les services d’incendie et de secours de différentes régions (linguistiques): «La façon de travailler est devenue très synchronisée au cours des dix dernières années.» Selon Werner Stampfli, les procédures standard apprises se sont avérées efficaces. Mais Werner Stampfli estime toutefois également qu'il y a, dans ce domaine, un besoin de développement.

Passer d’une tactique passive à une tactique active avec plan B
«Je pense que nous ne sommes toujours pas capables de penser avec suffisamment d’anticipation et que nous agissons trop souvent de façon réactive.» Il cite l’utilisation de grands ventilateurs comme exemple de la différence existant entre une tactique passive et réactive et une tactique proactive. Celui qui, en cas d’intervention dans un tunnel, ne fait appel à un grand ventilateur que lorsque c’est nécessaire agit à la situation de façon passive et réactive. Cela prend du temps. Il est donc préférable de disposer des moyens tactiques sur site et d’emporter directement un grand ventilateur afin que celui-ci soit disponible déjà avec l’arrivée sur place du premier groupe d’intervention. Avec une tactique active, il est possible d’apporter une réponse immédiate à une éventuelle rupture du flux d’air ou, par exemple, à une inversion des fumées.

«Nous avons effectivement assez rarement besoin d’un grand ventilateur, mais nous l’avons déjà utilisé à plusieurs reprises pour protéger efficacement le lieu de l’intervention en poussant ou en aspirant les fumées.» Le message de Werner Stampfli est donc que les responsables des services d’incendie et de secours doivent avoir un plan B avant de s’apercevoir que le plan A ne fonctionne pas. C’est pour cette raison qu’il maintient sa recommandation en faveur d’un plan B et enseigne cette approche en tant qu’instructeur dans les cours de conduite de l’International Fire Academy.
Qui dirige l’intervention?
A la question de savoir comment la direction de l’intervention est organisée en Suisse lors d’événements survenant dans des tunnels, Werner Stampfli répond en indiquant qu’il existe des avis et des pratiques différentes les unes des autres. Certains responsables des interventions dans les tunnels ont défini de façon précise la direction de l’intervention. Werner Stampfli voit cela d’un œil critique: «Je pense que celui qui trouve dans les meilleures conditions pour intervenir et qui n’est par exemple pas confronté à la problématique de la fumée, doit commencer immédiatement à intervenir et donc prendre la direction des opérations. Le principe est d’«éteindre pour sauver» et non pas d’attendre que les personnes ou les sapeurs-pompiers désignés dans le plan d’intervention pour prendre la direction de l’intervention arrivent enfin sur site.»

Trois concepts destinés à renforcer la disponibilité au quotidien
Ce n’est pas seulement dans le cas d’interventions dans des tunnels, qui requièrent un grand nombre de personnes, que les sapeurs-pompiers volontaires ou les sapeurs-pompiers de milice éprouvent des difficultés à mettre à disposition un nombre suffisant de personnels dans un délai raisonnable. Lors d’un entretien avec Christian Brauner, Werner Stampfli a présenté trois concepts destinés à renforcer la disponibilité au quotidien.
La première approche consiste à mettre à disposition des sapeurs-pompiers permanents pendant la journée, ce qui implique la création de casernes (régionalisation). Cela permet de garantir l’intervention durant la journée.
- Le deuxième concept est celui de la milice dite «de jour». Il s’agit de sapeurs-pompiers qui se rendent à tour de rôle à la caserne un ou plusieurs jours par semaine et qui y effectuent, par exemple, des tâches administratives pour leur employeur ou leur entreprise. En cas d’alarme, ils sont ainsi prêts à intervenir immédiatement, comme les sapeurs-pompiers professionnels. Les «co-working spaces» organisés en caserne se sont déjà avérés efficaces dans notre région.

En troisième lieu, Werner Stampfli a présenté une idée déjà mise en pratique depuis un certain temps, à savoir la possibilité d’être également incorporé dans le corps de sapeurs-pompiers de son lieu de travail. Cela offre, par exemple aux sapeurs-pompiers qui vivent dans une petite localité et qui travaillent dans une ville voisine, la possibilité d’acquérir davantage d’expérience en matière d’intervention, ce qui profite également à leur propre corps de sapeurs-pompiers local.
En réponse à la question des coûts générés par ces trois concepts, Werner Stampfli fait référence à l’objectif de telles mesures: «Au départ, l’idée n’était pas de faire des économies, mais de devenir plus efficace.»
La conduite se caractérise encore toujours par le courage de décider
En conclusion, Werner Stampfli souhaite que les personnes responsables de la conduite des interventions soient «celles qui dirigent et qui décident et non pas celles qui veulent remplacer les prises de décisions par des «workflows». Il affirme par ailleurs: «Nous pouvons utiliser certains outils, mais nous devons prendre position et décider, même si nous ne savons pas tout.» La seule chose qui compte pour les sapeurs-pompiers c’est le succès de l’intervention. Tous les intervenants devraient en tenir compte et ne pas se laisser distraire par trop de technologie.



![[Translate to French:] Stabsraum [Translate to French:] Stabsraum für den Lötschberg-Basistunnel mit Besprechungstisch und Funktionswesten über den Stuhllehnen](/fileadmin/user_upload/IFA/Bilder/7_MAG/ifa_MAG_418_Pilot67.jpg)
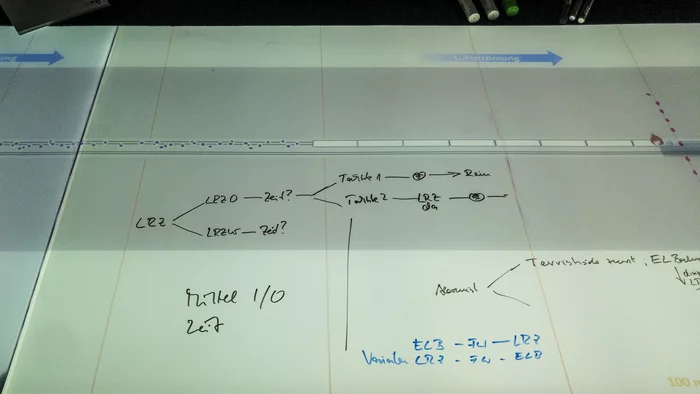
![[Translate to French:] [Translate to French:]](/fileadmin/_processed_/a/f/csm_ifa_MAG_088_Action_010_6281fdff5e.webp)